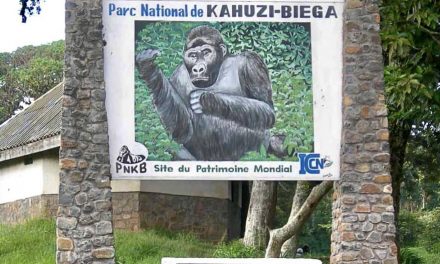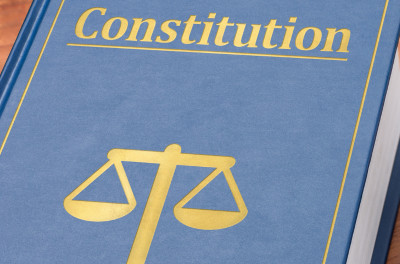Après de nombreux mois d’attente suite aux péripéties de l’examen du budget, et alors que notre agriculture traverse une grave crise, le Sénat a enfin examiné la loi d’orientation agricole, désormais dénommée “Loi pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations”. Celle-ci fait notamment suite aux manifestations des agriculteurs début 2024, où les questions de rémunération des paysans et d’exposition au libre-échange étaient centrales dans le mal-être exprimé.
Pourtant, ce projet de loi ignore superbement toutes ces questions de fond. Jamais nous n’avons pu parler sérieusement du revenu des agriculteurs et de leur protection face aux produits importés beaucoup moins cher, cultivés dans des conditions souvent catastrophiques sur le plan social et environnemental. A la place, le gouvernement et ses alliés de la droite sénatoriale ont préféré reprendre les obsessions exportatrices de la FNSEA et ont choisi de faire de cette loi une occasion pour déréguler dans tous les sens, espérant ainsi que la production décollera et que tous les problèmes des agriculteurs seront résolus.
Cette loi se résume donc à aller toujours plus dans le même modèle qui ruine les agriculteurs, conduit à leur disparition progressive dans nos campagnes, empoisonne leur santé, mais aussi celle de toute la population, et bien sûr cause des dommages environnementaux considérables. Pour donner un peu de cohérence aux différentes mesures de cette loi, qui viennent directement des lobbys de l’agro-industrie, le gouvernement et le rapporteur LR au Sénat, M. Laurent Duplomb, ont axé celle-ci autour de l’objectif de “souveraineté agricole”.
En affichant cet objectif noble et consensuel, le but est cependant d’empêcher toute réflexion et proposition de modèle alternatif. Avec mes collègues du groupe écologiste du Sénat, notamment Daniel Salmon, sénateur d’Ille-et-Vilaine et chef de file sur les questions agricoles, nous avons malgré tout porté de nombreux amendements et propositions pour faire en sorte que ce texte serve vraiment nos agriculteurs, en les aidant à changer de modèle et en facilitant leur installation. Nous aurions aimé pouvoir aborder plus directement les questions de revenus et de libre-échange, mais le texte ne s’y prêtait malheureusement pas et nos amendements auraient été irrecevables.
Sur le fond, voici les amendements que j’ai défendu. Vous pouvez en retrouver la liste complète, ainsi que le sort qui leur a été réservé lors des votes – très largement défavorable – sur le site du Sénat.
L’article 1er, qui élève la souveraineté alimentaire au rang « d’intérêt fondamental de la Nation » et introduit un principe – impossible à appliquer strictement – de non-régression de la production agricole française, a suscité des débats intenses. J’ai notamment dénoncé le flou juridique autour de ces objectifs et la suppression de toute référence à la transition agroécologique, notamment par la suppression de l’objectif de 21% d’ici 2030 de la part des surfaces agricoles en bio.
J’ai également critiqué la conception de la souveraineté alimentaire par le gouvernement et la droite sénatoriale, qui voient celle-ci uniquement par le prisme de la compétitivité et de la balance commerciale. En visant avant tout l’exportation, la France n’est donc pas réellement auto-suffisante. Pour les écologistes, le sujet n’est pas la compétitivité, mais l’adéquation entre notre production et nos besoins, et ce n’est pas aux marchés mondiaux d’imposer leurs règles.
Or, cette conception passe à côté de l’essentiel : si la France est, sur le papier, autosuffisante dans la plupart des productions agricoles, elle exporte énormément de produits bruts et importe ensuite énormément de produits transformés. Le tableau suivant, produit par France Agri Mer en 2023, démontre l’ampleur du phénomène.
Cette aberration est dûe à la fois au libre-échange, mais aussi au manque d’usines capables de transformer les produits agricoles.
Par ailleurs, notre agriculture a beau produire beaucoup, elle le fait en utilisant des engrais et produits phytosanitaires très majoritairement importés. La guerre en Ukraine, qui a fait exploser le prix des engrais, nous l’a récemment rappelé. Afin d’être véritablement souverains, j’ai donc plaidé pour engager de vrais plans de réduction de notre dépendance aux engrais azotés et aux produits phytosanitaires.
A la place de cette conception faussée de la souveraineté alimentaire, j’ai rappelé celle de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), pour qui la souveraineté alimentaire d’un pays ne se construit pas contre le reste du monde. Elle doit également prendre en compte les droits humains pour les paysans, le droit à l’alimentation de toute la population et les droits environnementaux. Autant d’aspects ignorés dans ce projet de loi.
Il a aussi été question de la planification de la production agricole future, à 20 ans. Si celle-ci est évidemment nécessaire, le gouvernement et la droite sénatoriale n’ont en réalité aucune vision sur le sujet, puisque cette planification se résume d’après eux à de la prospective de marché. A l’inverse, nous pensons que l’Etat doit intervenir pour encadrer le marché et organiser l’agriculture de demain.
La façon dont les enjeux d’installation des agriculteurs ont été abordés est également scandaleuse. En se contentant de créer un “bachelor agricole” principalement tourné vers le management, le gouvernement et la droite sénatoriale considèrent que l’agriculteur est uniquement un chef d’entreprise. Alors que nos agriculteurs vieillissent et que nombre de jeunes actifs souhaitent cultiver des terres, rien n’est fait pour lutter contre la concentration et la financiarisation des terres. En promouvant des exploitations toujours plus grandes, cette loi va accentuer les problèmes de dépopulation de nos campagnes et de mécanisation à outrance de l’agriculture, au détriment d’autres modèles. A l’inverse de cette logique, j’ai plaidé pour un plafonnement du nombre d’hectares lors des transmissions de terres agricoles, afin d’aller vers de plus petites exploitations.
Ce projet de loi a aussi été marqué par l’influence des discours techno-solutionnistes, qui voient dans la technologie la solution à tous les maux de l’agriculture, alors même que celle-ci endette lourdement nos agriculteurs et pose de nouveaux problèmes. J’ai ainsi dénoncé cette vision bornée, qui voit notamment dans le progrès technique la solution au changement climatique. Si la technologie peut bien sûr aider l’agriculture, son usage doit être réfléchi et maîtrisé et le changement climatique implique avant tout une adaptation des cultures et de l’élevage. Nous avons donc proposé une autre rédaction, axée autour de la sobriété et de l’agro-écologie.
Nous avons aussi discuté de la question de l’eau, fondamentale alors que cette ressource cruciale se raréfie du fait du changement climatique. A l’inverse des techno-solutionnistes qui espèrent un salut par le progrès technique, j’ai rappelé qu’il nous adapter nos cultures au nouveau régime hydrique. Il ne s’agit pas veut pas d’interdire toutes les retenues collinaires et l’irrigation, mais d’encourager l’indispensable adaptation, pour être prêts pour les prochaines sécheresses.
Là encore, le gouvernement est resté inflexible. Il a notamment voulu transférer la compétence eau aux départements, sans doute afin de faciliter la construction de méga-bassines. Au contraire, j’ai plaidé pour qu’elle reste gérée au niveau du bloc communal, à savoir à l’échelle intercommunale lorsque c’est possible, sinon à l’échelle communale. Tel est finalement ce qui a été retenu, venant clore un sujet d’inquiétude des communes depuis près de 10 ans.
Toujours en matière de fuite en avant, le gouvernement et la droite sénatoriale ont voulu supprimer toute “sur-transposition” de normes européennes, ce qui revient à autoriser toutes sortes de molécules et de produits chimiques extrêmement dangereux pour notre santé, celle des agriculteurs, nos sols et notre eau. J’ai rappelé que la “sur-transposition” n’est pas un problème, elle permet au contraire à la France de montrer la voie pour faire interdire des molécules dangereuses dans le reste de l’Europe, comme cela a souvent été le cas. Alors que les débats regorgent de formules sur “l’excellence agricole française”, il aurait été opportun de continuer à montrer l’exemple.
J’ai également dénoncé le scandaleux “avis de sagesse” de la ministre sur un amendement visant à réintroduire des produits phytosanitaires pourtant interdits par l’ANSES. Non seulement, le fait de refuser d’écouter le travail indépendant des scientifiques est absolument délirant, mais la ministre a également reconnu à demi-mot que ce qui était proposé était hors la loi…
Pire, le gouvernement et la droite sénatoriale ont réécrit l’article 13 de la loi pour dépénaliser des atteintes à l’environnement “non intentionnelles”. Une régression très grave, car elle permettra à des pollueurs de se dédouaner des conséquences de leurs actes. J’ai ainsi pris l’exemple de chasseurs qui tueraient “involontairement” des animaux ou d’industriels qui rejetteraient “involontairement” des eaux usées dans l’environnement, comme c’est le cas de l’usine Lactalis de “l’étoile du Vercors”, et qui bénéficieraient alors d’une relaxe.
Concernant toujours les atteintes à l’environnement, les apiculteurs sont en première ligne. Alors que la pollinisation est indispensable à la production agricole, et plus généralement à l’équilibre de la biodiversité, 30% des abeilles meurent chaque année. Cette hécatombe, qui place notre apiculture dans une grande crise, est directement liée à l’usage massif de pesticides. Alors que le Sénat souhaite réintroduire des néonicotinoïdes, j’ai rappelé ces faits et appelé à mieux protéger notre apiculture.
Enfin, j’ai également porté des amendements sur plusieurs aspects qui me semblaient oubliés dans ce texte. Alors que ce projet de loi prétend vouloir aider les agriculteurs à s’installer, la question du handicap n’a pas du tout été abordée. Le jour même du vingtième anniversaire de la loi de 2005, j’ai appelé à adapter les métiers agricoles au handicap, en offrant des moyens pour acquérir des machines adaptées et aménager les temps de travail, y compris en permettant d’embaucher des salariés agricoles. J’ai appuyé cette demande sur le témoignage d’un agriculteur drômois, qui a les deux membres inférieurs sectionnés.
J’ai également déposé un amendement pour encourager l’habitat réversible – également appelé habitat léger – sur les terrains agricoles, qui a malheureusement été jugé irrecevable. Je le regrette car cette solution est intéressante à double titre. En effet, elle permet à la fois de répondre aux difficultés de logement des agriculteurs, qui sont un frein important à l’installation, tout en évitant l’artificialisation des terres, ce qui est compatible avec le cadre du ZAN et la nécessité de préserver nos terres agricoles.
J’ai également porté plusieurs amendements pour aider nos éleveurs, car l’élevage pastoral traverse une crise importante. Il faut un véritable plan d’aide pour la filière.
Plus spécifiquement, j’ai de nouveau rappelé la nécessité d’avancer sur un statut juridique des chiens de protection, alors que de nombreux éleveurs rencontrent des problèmes judiciaires et des difficultés d’assurance en raison de ces chiens de protection, indispensables pour organiser la cohabitation avec le loup. J’ai donc proposé d’instaurer une présomption d’absence de vigilance des éleveurs et des maires, pour mieux les protéger en cas d’accident dus à des chiens de protection. C’est mon seul amendement qui a été adopté.
Toujours pour mieux aider nos éleveurs, j’ai également demandé la création d’une cinquième école de vétérinaires en France. Cette profession est en effet indispensable à l’élevage, mais plus de la moitié sont désormais formés à l’étranger, l’offre éducative en la matière étant insuffisante dans notre pays.
Enfin, j’ai également déposé un amendement pour demander un plan pour notre filière laine, alors que les éleveurs français se détournent de plus en plus de cette production peu rentable, pour favoriser la production de viande et de lait. Cela est regrettable, car la laine pourrait apporter un complément de revenus à nos éleveurs et permettre de réduire nos importations de textile depuis l’Asie, en fournissant un matériau naturel, maîtrisé depuis des siècles, plutôt que des tissus élaborés grâce à la pétrochimie, particulièrement polluante.
Malheureusement, l’écrasante majorité de nos propositions ont été rejetées par le gouvernement et la droite sénatoriale. Le texte a été entièrement réécrit par la chambre haute, pour aller vers un modèle encore plus productiviste que ce que prévoyait le texte initial. Comme l’ensemble du groupe écologiste, ainsi que les groupes socialiste et communiste, j’ai bien évidemment voté contre. Sous la pression du gouvernement, qui souhaitait une adoption avant le Salon de l’agriculture, la Commission Mixte Paritaire a été organisée dans la foulée, et celle-ci a été conclusive. Malgré cette défaite, soyez certain de ma mobilisation totale pour répondre aux vrais problèmes de l’agriculture française.
Crédit photo en une : Chris Ensminger