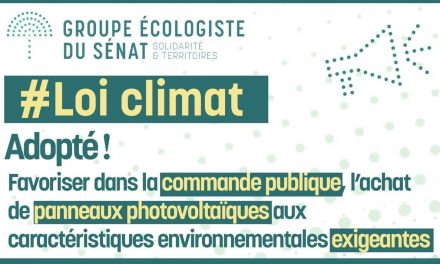Alerte : le futur régime d’autorisation pour nos barrages hydroélectriques, prévu par les négociations entre le gouvernement et la Commission européenne, représente une menace de privatisation déguisée. Un « ARENH hydro » est également prévu, au seul service des spéculateurs. Dans une tribune publiée sur Mediapart que j’ai initié, co-signée par de nombreux parlementaires écologistes, nous proposons une alternative garantissant la propriété publique de nos barrages : le régime de la quasi-régie.
Depuis l’absurde décision européenne d’ouvrir les concessions hydroélectriques à la concurrence, l’avenir de nos barrages est incertain. Produisant 14% de notre électricité et essentiels à la gestion de l’eau et à la transition écologique (notamment grâce aux capacités de stockage qu’ils permettent), les barrages sont jusqu’à présent propriété de l’Etat et exploités principalement par EDF (75% du parc) et par la Compagnie nationale du Rhône (CNR) et la Société Hydro-Électrique du Midi (SHEM), propriétés d’ENGIE. Avec deux contentieux contre la France, la Commission européenne a empêché le renouvellement habituel de ces concessions, ce qui bloque tout investissement pour augmenter la production des barrages depuis des années. Un comble, alors que la France dispose d’un vaste potentiel en améliorant les installations existantes.
Ce statu quo n’a que trop duré, même s’ il permettait temporairement d’empêcher la privatisation de nos barrages, bien plus dangereuse. En effet, la privatisation auraitconduit à une gestion strictement financière, avec un entretien minimal et une production d’électricité lorsque les prix sont au plus haut, plutôt que de prendre en compte tous les usages de l’eau (agriculture, industrie, usage domestique, refroidissement des centrales nucléaires, tourisme, préservation de la biodiversité…). Pour les énergéticiens privés, les barrages français sont une poule aux œufs d’or : amortis depuis longtemps, ils procurent une rente sans effort. Nous nous sommes donc toujours fermement opposés à toute mise en concurrence et à toute privatisation de nos barrages, trop stratégiques pour les confier à des financiers.
Fin août, le gouvernement Bayrou a annoncé avoir trouvé un accord avec la Commission européenne pour sortir du blocage. Aussitôt présenté comme une victoire, cet accord, qui suit les recommandations du rapport parlementaire conduit par les députés Marie-Noëlle Battistel (PS) et Philippe Bolo (MODEM), n’est pas public. Ce manque de transparence et les propos contradictoires qui sont tenus à chaque fois que ce deal est évoqué trahissent sa véritable nature : il ne s’agit pas d’une victoire contre la privatisation des barrages, mais d’une capitulation devant les exigences absurdes de la Commission européenne, que d’autres pays européens, comme l’Allemagne, ont simplement choisi d’ignorer.
Que prévoit cet accord ? D’abord, le passage en régime d’autorisation, c’est-à-dire le transfert de la propriété des grands barrages de l’Etat vers diverses entreprises (la question de la propriété foncière étant incertaine à ce stade). EDF, déjà fortement endettée, devra-t-il racheter les barrages qu’elle exploite déjà ? Y aura-t-il des ventes aux enchères permettant à d’autres acteurs d’acquérir des barrages, ce qui équivaudrait donc à une privatisation ? La possibilité d’une propriété privée des barrages est en tout cas évoquée sans détour pour les nouveaux ouvrages dans le rapport Battistel-Bolo, tandis que le flou persiste pour ceux déjà existants. Même si les barrages actuels étaient repris par EDF, une future privatisation sera toujours possible, par exemple à l’occasion de co-investissements pour développer les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) auxquels participeraient des multinationales ou des fonds de pension.
Le flou entretenu autour de l’accord avec la Commission européenne nous fait donc craindre qu’il ne cache une privatisation déguisée. Par ailleurs, cette option n’apporte aucune sécurité juridique, les concurrents d’EDF pouvant multiplier les recours si l’exploitant historique obtient la plupart des ouvrages.
C’est pour répondre à cet “abus de position dominante” d’EDF que cet accord prévoit un dispositif de compensation. Concrètement, EDF devrait revendre 6GW d’électricité, soit un tiers de sa production hydroélectrique, à ses concurrents, à un prix qui n’est pas encore défini. Si celui-ci est inférieur aux coûts de production, cela signifiera une perte nette pour EDF. Dans le cas contraire, rien n’empêchera les acheteurs de revendre cette électricité virtuelle bien plus chère, empochant une belle marge au passage. Ainsi, EDF devrait partager sa rente avec ses concurrents, qui n’ont jamais dépensé un centime dans la construction d’un barrage ou exploité un seul ouvrage en France ! Cette usine à gaz rappelle le scandale de l’ARENH, qui a ruiné EDF et alourdi les factures des Français au seul bénéfice de spéculateurs qui n’ont jamais produit la moindre électricité !
Au vu des enjeux de souveraineté, de transition écologique et de gestion de la ressource en eau que présentent nos barrages, nous ne pouvons laisser passer un tel accord. Si nous exigeons en priorité d’en connaître les détails, nous rejetterons tout texte qui aboutirait à une privatisation, fusse-t-elle déguisée, et établirait un mécanisme financier byzantin au service des spéculateurs. Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour garantir le monopole public de nos barrages.
Surtout, nous rappelons qu’une alternative existe : l’instauration d’une quasi-régie. Celle-ci répond à tous les enjeux liés à nos barrages : elle garantit leur propriété publique et donc notre souveraineté, permet un tarif réglementé basé sur les coûts réels de l’hydroélectricité – bas et stable pour les consommateurs et suffisant pour EDF pour financer les investissements nécessaires -, simplifie la coordination entre les barrages et les centrales nucléaires en évitant la multiplication des exploitants, apporte la sécurité juridique nécessaire pour mener les investissements et est compatible avec le maintien du statut des salariés. Déjà proposée au Sénat en 2021, cette option a été reconnue comme possible par la Commission européenne, mais a été écartée sans raison par la mission parlementaire Battistel-Bolo et le gouvernement. Nous exigeons donc un vrai débat de fond prenant en compte l’option de la quasi-régie, qui nous apparaît comme la plus simple et la plus complète à ce jour.
Credit photo en une : versgui (Wikimedia Commons)